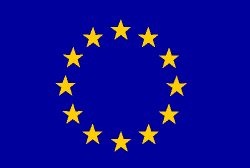
Le drapeau du Conseil de l'Europe deviendra l'emblème de l'Europe communautaire
De la fin du Moyen-Age
jusqu'à la période contemporaine,
et alors même que se réalisait la division politique de l'Europe,
divers projets précurseurs virent le jour pour rassembler dans un cadre
commun des nations héritières d'une communauté de civilisation.
Mais il faudra attendre le XXème siècle pour voir
se concrétiser les premiers efforts de réalisation.
Après la première guerre mondiale, en 1922, le comte Coudenhove-Kalergi
défend l'idée d'une forme de fédération européenne
et crée un mouvement intitulé l'Union Pan-européenne
pour promouvoir un projet dans ce sens. En 1929, Aristide Briand présente
devant la Société Des Nations un projet visant à "l'organisation
d'un régime d'union fédérale européenne".
Cette première tentative officielle n'aboutit pas et l'Europe se trouve
bientôt entraînée dans un nouveau conflit.
Malgré
ce premier pas, auquel s'associent six pays européens, la difficulté
de hâter le processus d'intégration politique ne tarde pas à
réapparaître et, en 1954 avec l'échec de la Communauté
Européenne de Défense, on doit renoncer au projet d'extension
du champ communautaire à des compétences plus spécifiquement
politiques. C'est donc dans le domaine économique que la construction
communautaire est poursuivie avec la formation de la Communauté Economique
Européenne, la CEE, et de la Communauté Européenne de
l'Energie Atomique, la CEEA (traités de Rome, 1957).
Même si les progrès de l'intégration européenne
ne vont pas toujours sans heurts, le cadre tracé dans les années
1950 montre son efficacité. De nouveaux pays rejoignent les six membres
fondateurs des Communautés. L'union douanière devient marché
unique puis union monétaire. La Communauté devient Union et
développe de nouvelles formes de coopération dans des domaines
plus politiques.
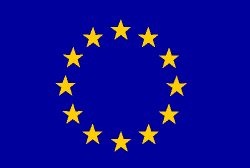

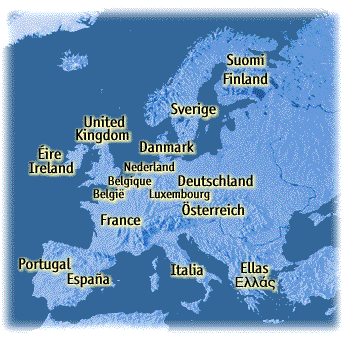
source
: europa.eu.int
Les 15 pays membres de l'Union Européenne sont en 2001 :
depuis 1957 : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas.
depuis 1973 : Danemark, Irlande, Royaume-Uni.
depuis 1981 : Grèce. depuis 1986 : Espagne, Portugal.
depuis 1995 : Autriche, Finlande, Suède.
