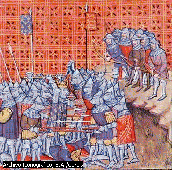
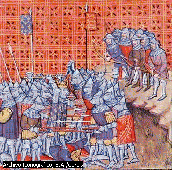

" Nous avons efté delivrez
à plain de prifon, & fommez franc & delivré à touzjours "
Pour s'acquitter de la promesse de rançon
qui l'a rendu franc et assainir les finances de son royaume, le roi signe
à Compiègne, le 5 décembre 1360, avant même d'être arrivé à
Paris, une ordonnance fiscale et monétaire.
" … Nous voulons qu'il appere clerement au pueple, que Nous avons entencion & propos ferme de tenir & garder & faire tenir & garder la forte Monoie par la maniere qui s'enfuit ; c'eft à favoir, que Nous avons ordené & ordenons que le Denier d'Or fin que Nous faifonz faire à prefent & entendonz à faire continuer, fera appellé Franc d'Or … "
Le franc est né…
Il est né sous les traits du franc à cheval : le roi à cheval au galop, armé de toutes pièces, coiffé d'un heaume surmonté d'un grand lys, porte une tunique fleurdelisée ; le caparaçon du cheval est brodé de fleurs de lys ; le roi tient la bride d'une main et de l'autre brandit une épée ; en inscription circulaire, on lit Johannes Dei Gratia Francorum Rex.
Physiquement,
le franc demeura, sous l'Ancien Régime, une monnaie rare. Dès 1365, Charles
V fit frapper un denier d'or aux fleurs
de lys, qui ne dut qu'à l'usage d'être
rapidement baptisé franc à pied.
Si l'on excepte la frappe d'un nouveau franc
à cheval sous Charles VII et celle de
pièces d'argent dénommées franc
sous Henri III, les monnaies de l'Ancien Régime sont davantage représentées
par l'écu puis le louis. Il fallut attendre la Révolution pour voir renaître
le franc.
Néanmoins, l'usage du mot a perduré comme synonyme de livre. Le grammairien
Vaugelas précise que l'on peut employer indifféremment les deux termes si
le compte est rond mais non s'il ne l'est pas : on peut dire 10 livres
ou 10 francs, mais on doit dire 10 livres 10 sous. Les auteurs classiques
offrent d'autres exemples de l'emploi du mot franc.


Franc
à cheval
© Musée de la Monnaie
de Paris